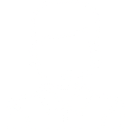Réparation intégrale du préjudice
Incidences du principe de réparation intégrale du préjudice
Quel est le concept de réparation du préjudice ?

« Tous les préjudices, rien que les préjudices », telle est la formule qui illustre le mieux le principe de la réparation intégrale du préjudice en droit de la responsabilité extracontractuelle.
L’idée est de rétablir, autant que possible, la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu (Cass. Civ. 28/10/1954, « statu quo ante delictum »). Etant précisé que les dommages et intérêts punitifs sont en principe exclus en dehors des rares cas prévus par la loi (ex : amende civile ou astreinte).
Il ne peut résulter de cette réparation ni appauvrissement, ni enrichissement. Ainsi, le juge ne peut allouer une réparation symbolique ou forfaitaire. Le dommage à l’origine du préjudice doit être réparable, c’est-à-dire être né, direct, personnel et certain. En effet, le juge ne peut réparer un dommage simplement hypothétique. De même, le juge ne doit pas indemniser deux fois un même préjudice sous des qualifications différentes.
Cette réparation intégrale est-elle systématique ?
La réparation intégrale, sans perte ni profit, connait quelques exceptions. Il en est ainsi en matière de droit contractuel où seuls les dommages prévisibles sont en principe réparables (article 1231-3 code civil). Les dommages et intérêts ne pourront donc pas excéder ce qui a été prévu ou ce qui était prévisible lors de la conclusion du contrat sauf lorsque l’inexécution résulte d’une faute lourde ou dolosive.
En outre, des clauses limitatives de réparation sont admises dès lors qu’elles ne contredisent pas la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur. Cet instrument permettant de limiter par avance le montant des dommages et intérêts en cas d’inexécution peut être écarté par le juge s’il constate que son montant est dérisoire par rapport au prix du contrat, ne reflète pas suffisamment la répartition du risque et n’a pas pu être librement négocié entre les parties*.
*Exemple Chronopost : la société Chronopost s’engage à transporter un colis de grande valeur d’un point A à un point B en l’échange du paiement d’un prix de 70 euros et le contrat contient une clause limitative de réparation non négociable qui limite à 60 euros l’indemnisation due par Chronopost en cas d’inexécution de son obligation de transport.
En l’espèce, le plafond d’indemnisation (60 euros) serait dérisoire car la société Chronopost pourrait ne pas exécuter le contrat et continuer malgré tout à dégager un profit (10 euros) grâce au jeu de la clause limitative de réparation… Par ailleurs, le plafond d’indemnisation n’est pas nécessairement corrélé au préjudice que subi le créancier s’agissant d’un colis de grande valeur (contenu ou enjeu de délivrance). L’obligation essentielle de la société Chronopost serait vraisemblablement vidée de toute substance.
Comment la réparation intégrale est-elle mise en place ?
Réparer intégralement le préjudice implique d’identifier et qualifier rigoureusement les préjudices subis par la victime, notamment en matière de dommage corporel, afin d’éviter toute omission et qu’un même préjudice ne soit réparé deux fois sous deux qualifications différentes. A cette fin, la nomenclature Dintilhac recense de façon non exhaustive un ensemble de préjudices indemnisables selon leur nature. En principe, l’évaluation du préjudice a lieu au jour du jugement.
La victime a droit à une compensation qui couvre tous les préjudices subis, qu’ils soient matériels ou immatériels. Cela inclut les dommages corporels, moraux, économiques, et autres pertes directement liées à l’événement dommageable.
L’individualisation de la réparation des préjudices est le corollaire du principe de réparation intégrale dans le sens où les victimes peuvent faire valoir leurs préjudices en tenant compte de leurs conditions de vie et leur personne. Ainsi, les conséquences et l’indemnisation d’un dommage seront différentes selon votre âge, votre sexe, votre profession, vos ressources etc…
Sous quelle forme se présente-t-elle ?
Sur le plan théorique, la réparation en nature est possible mais est souvent impossible en raison de la nature du dommage (ex : réparation d’un bien meuble corporel endommagé). Par conséquent, la réparation prend bien souvent la forme de dommages et intérêts versés sous la forme d’un capital ou d’une rente.

Le comportement de la victime limite
Il s’évince du principe de réparation intégrale que la victime n’a pas à minimiser son préjudice ou d’en éviter son aggravation. Par exemple, la victime d’une infection nosocomiale n’est pas tenue de limiter son dommage et son refus de soin n’a aucune incidence sur son droit à indemnisation (Cass. Civ. 1ère 15/01/2015). En dehors du cadre médical, un notaire responsable d’un manquement à son devoir d’information ne pouvait reprocher à ses clients de ne pas avoir opté pour un dispositif de défiscalisation alternatif proposé par l’Administration fiscale pour limiter leur préjudice (Cass. Civ. 1ère 02/07/2014).
Pour conclure, le principe de réparation intégrale sous-tend la responsabilité civile objective selon laquelle toute personne qui cause un dommage à autrui, fut-ce involontairement, est tenue de réparer ce dommage. La réparation intervient donc indépendamment de l’existence d’une faute. L’on peut en déduire que l’articulation de ces mécanismes procède d’un mouvement d’indemnisation ayant les faveurs du législateur et du pouvoir judiciaire.

romain kerscaven
Juriste